
Mercredi 1er avril. Deux cloches pour ce soir : Guibert et Benoît, fa# et la, soit une tierce mineure. Bel intervalle pour une sonnerie à deux cloches, plus aigüe qu’hier.
Encore quelques mots sur les remparts. Il nous en reste une série de vestiges, parfois méconnus. A l’entrée de Gembloux, devant l’entrée de la Faculté, se trouve un reste du mur d’enceinte qui sépare le passage des Déportés de la place Saint-Jean. Dans l’immeuble blanc situé à l’angle de la Grand-Rue et de la place Saint-Guibert, on observe un renfoncement englobant les fenêtres de droite du rez-de-chaussée et du premier étage. Il illustre la hauteur que devait avoir l’enceinte qui passait par-là. La conciergerie de l’ancienne abbaye repose, sur sa gauche, sur un reste du mur, visible aussi dans l’immeuble adjacent.
Des vestiges des remparts subsistent dans quelques maisons (surtout dans les caves) de la place Saint-Guibert et de la rue Docq. De nombreuses constructions se sont appuyées sur les vieux murs. On retrouve le mur dans le bar de la brasserie l’Estaminet.
Nous conservons aussi deux tours d’angle : la tour nord, rue du Moulin au square Albert 1er et la tour sud, entre la rue Docq et le parc d’Epinal.
La première est improprement appelée tour des Sarrasins. Au moment où ont été bâtis les remparts en 1153, il n’était plus question de Sarrasins dans nos contrées et, du reste, s’ils avaient dû se présenter à Gembloux, ils ne seraient pas arrivés par ce côté.
Les illustrations jointes montrent les traces d’arrachement des murs sur ces tours d’angle qui ont été plusieurs fois réparées.
Il existe encore une troisième tour, à l’angle de la rue Docq et de la rue du Chien Noir, mais il s’agit d’une adaptation contemporaine de vestiges et il ne faut pas y voir d’image précise de ce qu’étaient les fortifications.
Dans le cadre des réaménagements à venir, la Ville envisage la reconstruction de l’enceinte médiévale et de ses portes.



Illustrations : IRPA, Google streetview et photo de Jean-Marc Gilles – article Manu Delsaute
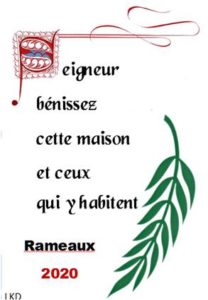










 Lundi 30 mars. Au programme de ce soir, trois cloches comme hier aussi mais 3-5-6 (fa#, si, do#) au lieu de 3-4-5. L’écart se creuse entre la première et les suivantes, ce qui lui permet de bien se détacher. Pour les musiciens : quarte et quinte.
Lundi 30 mars. Au programme de ce soir, trois cloches comme hier aussi mais 3-5-6 (fa#, si, do#) au lieu de 3-4-5. L’écart se creuse entre la première et les suivantes, ce qui lui permet de bien se détacher. Pour les musiciens : quarte et quinte.
 Dimanche 29 mars. Autre sonnerie de trois cloches, avec un accord différent : Guibert, Benoît et Romane, ce qui donne fa#, la, si. Un ton et demi entre les deux premières, un ton entre la deuxième et la troisième. Pour les musiciens : tierce mineure et quarte. La plus grosse cloche se détache davantage des deux autres.
Dimanche 29 mars. Autre sonnerie de trois cloches, avec un accord différent : Guibert, Benoît et Romane, ce qui donne fa#, la, si. Un ton et demi entre les deux premières, un ton entre la deuxième et la troisième. Pour les musiciens : tierce mineure et quarte. La plus grosse cloche se détache davantage des deux autres.
 Samedi 28 mars. Ces six derniers jours, nous avons fait la connaissance de nos cloches de volée et nous avons pu constater une disparité d’âge. Nous écouterons ce soir la plus ancienne et les deux plus récentes. Benoît, Romane et Benjamine se marient à merveille pour produire une sonnerie joyeuse : la, si, do#, soit un ton entre chaque cloche.
Samedi 28 mars. Ces six derniers jours, nous avons fait la connaissance de nos cloches de volée et nous avons pu constater une disparité d’âge. Nous écouterons ce soir la plus ancienne et les deux plus récentes. Benoît, Romane et Benjamine se marient à merveille pour produire une sonnerie joyeuse : la, si, do#, soit un ton entre chaque cloche.
 Vous souvenez-vous, au début du carême, nous nous étions mis en route ensemble pour aller à la rencontre de Dieu ? Semaine après semaine, nous avons progressé à la suite de Jésus, par Lui, nous nous sommes approchés de notre Père. Aujourd’hui, Jésus nous parle comme il parle à son ami Lazare dans l’évangile. Il nous demande de sortir de nos tombeaux. Tombeaux de l’égoïsme, du repli sur soi : Si tu veux rencontrer Dieu, entends la voix qui t’appelle à sortir de ton tombeau
Vous souvenez-vous, au début du carême, nous nous étions mis en route ensemble pour aller à la rencontre de Dieu ? Semaine après semaine, nous avons progressé à la suite de Jésus, par Lui, nous nous sommes approchés de notre Père. Aujourd’hui, Jésus nous parle comme il parle à son ami Lazare dans l’évangile. Il nous demande de sortir de nos tombeaux. Tombeaux de l’égoïsme, du repli sur soi : Si tu veux rencontrer Dieu, entends la voix qui t’appelle à sortir de ton tombeau